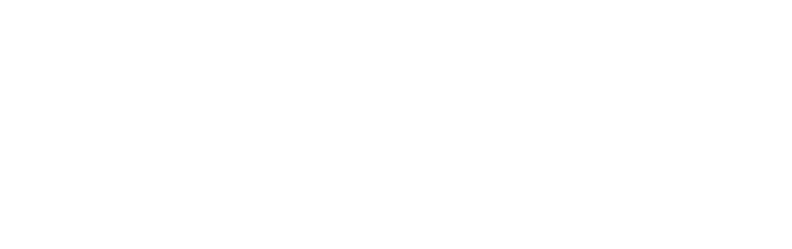Des stations de biosécurité sur les sentiers de randonnée à La Réunion : quelle efficacité comme freins à la propagation de plantes exotiques envahissantes ?
Les EEE constituent une menace pour la biodiversité de La Réunion qui abrite de nombreux espaces naturels bien préservés caractérisés par une grande diversité de plantes endémiques. Parmi ces EEE, plus de cent espèces végétales exotiques introduites (PEE) sur ce territoire par les activités humaines sont identifiées comme envahissantes et exercent une importante pression sur la flore réunionnaise. Après un premier bilan en 2019 qui estimait à 30 % le risque d’extinction de la flore vasculaire de l’île, un nouvel état des lieux réalisé en 2023 montre une aggravation de la situation avec actuellement 41 % d’espèces menacées par ces PEE comme première menace, impactant tous les étages de la végétation.
Ce phénomène, déjà bien identifié à La Réunion depuis plusieurs décennies, donne lieu à de nombreux chantiers de gestion de ces espèces, destinés à en réduire les impacts. Par ailleurs, la prévention des introductions, grâce notamment à la mise en œuvre de mesures adaptées de biosécurité, constitue le moyen le plus efficace et le moins onéreux pour freiner les invasions biologiques. Cette biosécurité peut s’appliquer à la prévention d’introductions d’EEE sur un territoire, mais peut aussi permettre d’y empêcher ou au moins limiter la dispersion d’espèces déjà introduites vers des milieux à enjeux de conservation où elles sont encore absentes. C’est ce que le Parc national de la Réunion (PNRun) et l’ONF expérimentent depuis 2017 par l’installation de stations de biosécurité à destination des usagers des sentiers pédestres permettant d’éviter le transport accidentel de propagules de plantes exotiques envahissantes (PEE) vers les milieux naturels.
Premier test du dispositif sur le sentier des Trois Sources lors d’un trail organisé en 2017

1- Sentier de biosécurité sur le sentier des Trois Sources © PNRun
L’utilisation d’une telle station de biosécurité a été expérimentée parmi d‘autres mesures en réponse à une alerte de l’UNESCO sur l’état d’envahissement de l’île et son appel à endiguer le phénomène. Ce premier dispositif a été conçu par l’ONF puis installé par le PNRun à l’entrée du sentier des Trois Sources à l’occasion du Grand Raid d’octobre 2017. Un suivi de son utilisation a été réalisé le temps des courses durant les 3 éditions du raid, en 2017, 2018 et 2019.
Ces stations étaient composées de grilles métalliques posées au sol et installées au-dessus d’un bac de récupération permettant la collecte de la terre accrochée aux chaussures des coureurs. Chacun d’entre eux devait ralentir son allure pour se déplacer au pas sur le dispositif et sautiller sur les grilles pendant quelques secondes (Fig. 1).
La terre récoltée a été transmise au CBN – CPIE de Mascarin et mise en culture dans un bac pour réaliser des tests de germinations. Plus de 1 200 germinations ont ainsi été dénombrées dans les échantillons de terre des trois années, dont 614 plantules correspondant à la course de 2017, 518 plantules à celle 2018 et 116 à celle de 2019.

2- Nombre de germination et diversité des échantillons en fonction de leur coefficient d’invasibilité (cumul des 3 années) Source : CBNM-CPIE Mascarin
Parmi les espèces ayant germé, 9 sont des PEE, les plus abondantes étant des taxons aux coefficients d’invasibilité les plus élevés de l’échelle de Lavergne (Fig. 2). Ce premier test a donc confirmé la contribution non-intentionnelle possible des participants à ces manifestations sportives à la propagation de PEE qui peuvent ainsi non seulement introduire accidentellement de nouvelles espèces exotiques dans des zones auparavant préservées (Fig. 3a), mais aussi faciliter le renforcement de populations d’espèces déjà répandues le long des sentiers (Fig. 3b).
 |
 |
3- Mécanismes de propagation involontaire d’EEE par des randonneurs a) dans le cas de la colonisation d’une nouvelle zone b) dans le cas du renforcement permanent de la cohorte des EEE le long des sentiers
Ces premiers résultats montraient tout l’intérêt de l’utilisation de tels dispositifs et encourageaient donc leur déploiement sur d’autres sites accueillant des visiteurs, à améliorer les dispositifs de protection des milieux naturels et contribuer à un changement plus généralisé des pratiques d’accès dans ces milieux fragiles.
Deux nouvelles stations de biosécurité à Grand Coude lors de la création d’un sentier en 2019
Contexte et choix des emplacements
Deux autres stations de biosécurité ont été installées à l’entrée de la forêt domaniale de Grand Coude au Morne Langevin sur la commune de Saint-Joseph. Cette forêt de type mésotherme hygrophile et incluse dans le périmètre du bien classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, abrite en effet de nombreuses espèces épiphytes et comptabilise 110 espèces indigènes dont 8 menacées d’extinction d’après la liste rouge nationale de l’UICN. Neuf PEE y ont été dénombrées mais n’y sont encore présentes que ponctuellement. Toutefois, le sol argileux de cette forêt est favorable à l’accrétion de terre sous les chaussures, aussi le projet d’ouverture d’un sentier pédestre constituait un risque de propagation de plantes exotiques dans des zones initialement non fréquentées. De plus, les travaux de spatialisation des zones prioritaires pour la gestion des PEE à l’échelle de l’île ont classé la forêt de Grand Coude en « priorité 1 » du fait de ses forts enjeux de conservation et de son faible niveau actuel d’envahissement.

4- Station de biosécurité conçue pour l’ouverture du sentier de la forêt de Grand Coude
La nouvelle station de biosécurité a donc été conçue pour les ouvriers en charge de la création du sentier afin d’éviter la dispersion de graines lors de leurs travaux. Une première station permanente (1) a été mise en place à l’entrée du sentier et d’un secteur envahi par la Jouvence (Agertatina riparia). Cette plante exotique a fait l’objet d’un chantier de gestion avant et pendant les travaux et une seconde station temporaire (1 bis) a été installée à quelques centaines de mètres de la première après le secteur géré pour éviter la dispersion de l’espèce dans la forêt. Ces deux stations sont inspirées de celles utilisées sur le sentier des Trois Sources mais ont été améliorées pour permettre un nettoyage plus complet des chaussures et du matériel des ouvriers (Fig. 4). Un panneau avec un mode d’emploi a été installé sur le dispositif pour faciliter sa bonne utilisation.
Analyse des volumes de terre récoltés
Les résidus de terre contenus dans ces deux stations ont été récoltés par les agents du PNRun à 4 reprises tous les 4 mois pendant un an entre 2019 et 2020. Au total 68 kg de terre ont été récoltés pendant cette période soit une moyenne de 17 kg/prélèvement et plus de 2 kg kg/mois/station , témoignant de l’utilisation correcte des stations par les ouvriers. Les terres collectées ont été réparties en 8 lots transmis au CBN-CPIE de Mascarin pour la mise en culture et l’identification des germinations. Cependant, compte-tenu des quantités importantes de terre récoltés, l’analyse a porté sur un échantillon par lot de 1,5 à 3 kg, chacun réparti dans 3 bacs. Au total, 24 bacs ont été mis en cultures et les germinations s’y produisant ont été identifiées dans la mesure du possible au rang de l’espèce, sinon au rang de la famille (Fig. 5).
 5- Germinations dans une terrine en culture © CBN-CPIE Mascarin |
 6- Nombre et proportion de taxons ayant germé par station selon leur statut d’indigénat. Source : CBN-CPIE Mascarin |
Les bacs des station 1 et 1 bis ont respectivement permis la germination de 1313 et 1196 graines soient 2509 germinations au total, représentant une moyenne de 147 germinations/kg de terre collectée. Les deux stations ont respectivement intercepté des graines de 57 et 55 taxons différents. Leurs résultats sont relativement similaires en termes de proportions des statuts d’indigénat, avec plus d’un tiers des germinations correspondant à des taxons indigènes et la moitié à des taxons exotiques, la portion restante regroupant des plantules indéterminées (Fig. 6).

7- Abondance des germinations des 13 taxons les plus représentés dans les terrines (> 10). Source : CBN-CPIE Mascarin
Au total 34 taxons, soit 48 % des espèces identifiées, sont exotiques, parmi lesquels 13 sont considérés comme les plus impactants pour les milieux naturels à La Réunion et classés en invasibilité 4 ou 5 sur l’échelle de Lavergne 5 (Fig. 7 et 8). L’espèce exotique la plus représentée est le Bringellier marron (Solanum mauritianum) déjà très présent en amont du sentier mais absent de la forêt de Grand Coude, sauf peut-être à l’état de graines dispersées par les oiseaux. A l’exception de cette dernière et de la Jouvence, les autres espèces exotiques identifiées dans les terrines sont actuellement absentes de la forêt de Grand Coude et les stations de biosécurité semblent donc avoir joué correctement leur rôle d’interception lors des travaux de création du sentier.

8- Nombre de germinations d’EEE classées selon leur catégorie d’invasibilité (échelle de Lavergne de 1 à 5 sur l’axe des ordonnées). Source CBN-CPIE Mascarin
Une efficacité probablement encore sous-estimée
Bien que ces chiffres confirment l’efficacité de ces stations de biosécurité, ils restent sans doute sous-évalués car ne décrivent que partiellement les interceptions qu’elles peuvent permettre :
-
Seulement un quart de la quantité de terre collectée à Grand Coude a été mis en culture et l’inventaire des taxons n’est donc peut-être pas exhaustif. La définition d’une stratégie concernant les protocoles expérimentaux d’échantillonnage et de mise en germination des terres récoltées permettant d’obtenir la germination d’une diversité d’espèces suffisamment représentative de ce qui est effectivement transporté par les visiteurs, pourrait être utile pour optimiser les suivis.
-
Le protocole appliqué a permis de quantifier les espèces dont les graines étaient viables et qui sont parvenues à germer. Il n’inclut pas les graines en dormance ni celles pour lesquelles la germination a échoué. De plus, un suivi de 6 mois est sans doute trop court pour laisser germer l’ensemble des graines des différentes espèces présentes dans les terres : un suivi de 18 mois permettrait probablement de réaliser un inventaire plus complet.
-
La deuxième station a permis la collecte de trois fois moins de terre que la première. Il se peut que cette première station ait permis d’alléger assez fortement la terre sous les chaussures avant le passage sur la seconde mais il est également possible que les ouvriers l’aient un peu moins utilisée. La représentativité des résultats obtenus reste donc étroitement liée à la bonne utilisation des dispositifs qui reste difficilement contrôlable au fil du temps
Il n’est pas possible d’évaluer la quantité de terre possiblement transportée par personne sans utiliser d’éco-compteurs de passage. Leur intégration au dispositif de biosécurité pendant la durée des études permettrait d’effectuer ce calcul et de comparer les résultats avec d’autres sentiers dotés de dispositifs similaires. Par ailleurs, une surveillance de long terme des milieux traversés par les sentiers permettrait de mieux évaluer dans quelle mesure des plantes exotiques peuvent être transportées sous les chaussures malgré l’utilisation des stations. En complément, l’utilisation de stations témoins permettrait de distinguer la provenance des espèces entre celles issues de la “pluie naturelle des graines” et celles transportées sous les chaussures des usagers.
Un outil de mobilisation des usagers
Un livret a été conçu en 2021 à destination des agents du Parc national de La Réunion pour faciliter l’application de consignes de biosécurité dans le cadre de leurs missions de terrain. Il présente différents cas de figure (nettoyage du matériel, nettoyage du véhicule, bivouac…).

9- Extraits du livret sur les mesures de biosécurité. Source : Parc national de La Réunion
Un chapitre y est spécifiquement dédié aux protocoles à suivre lors de l’accès aux colonies de pétrels noirs de Bourbon (Pseudobulweria aterrima) et pétrels de Barau (Pterodroma baraui) et à la manipulation de ces oiseaux. En effet, ces deux espèces d’oiseaux endémiques de La Réunion, respectivement classées en danger critique d’extinction et en danger d’extinction sur la liste rouge nationale de l’UICN, en plus d’être menacées par des prédateurs exotiques, pourraient être impactées par des pathogènes introduits et par les modifications de la structure de leur habitat générées par la propagation d’EEE végétales, d’où des prescriptions spécifiques en matière de biosécurité.
Consulter et télécharger le livret
L’installation de ces dispositifs a ainsi permis la sensibilisation des agents du Parc national de La Réunion aux bonnes pratiques de biosécurité et la première station permanente est depuis utilisée par les randonneurs. En 2021, l’éco-compteur de l’ONF installé sur le sentier de Grand Coude a comptabilisé 18 096 personnes soit un flux mensuel de 754 personne. En 2022, plus d’1,5 million de passages ont été comptés par l’ensemble des éco-compteurs installés sur les sentiers de l’île, soulignant la nécessité de déployer ces mesures de prévention à plus large échelle.
Déploiement du dispositif en 2023 avec 4 nouvelles stations à destination des randonneurs
Pour mieux évaluer la fréquentation élevée de certains sentiers par les randonneurs, 4 nouvelles stations ont été installées en 2023 sur des sites stratégiques avec le soutien de la fondation Entreprise groupe EDF qui a permis leur conception, leur fabrication et leur pose. Elles ont été mises en place à l’interface de milieux envahis et préservés. Du fait des caractéristiques des dispositifs (poids, dimensions, etc.) et des sentiers ciblés, les stations ont été héliportées jusqu’aux sites :
Morne Langevin (1 station)
- Fréquentation annuelle : 5400 visiteurs en 2022
- Type de milieu : Forêt tropicale de montagne au vent
- Plantes exotiques identifiées comme principaux risques : Goyavier, Passiflore, Jouvence
- Remarque : Cette station complète le dispositif mis en place lors de l‘ouverture du sentier afin d’augmenter l’efficacité de la prévention à ses deux extrémités.
Forêt de Mare Longue (1 stations)
- Fréquentation annuelle : 17 000 visiteurs en 2022
- Type de milieu : Forêt tropicale humide de basse altitude
- Plantes exotiques identifiées comme principaux risques : Jamrosat, Tabac Boeuf, Raisin marron
Maïdo (2 station)
- Fréquentation annuelle : 40 000 visiteurs en 2022
- Type de milieu : Végétation éricoïde de haute altitude
- Plantes exotiques identifiées comme principaux risques : Ajonc d’Europe, Houlque laineuse, Flouve odorante
- Remarque : l’Ajonc d’Europe prolifère rapidement sur ce site à la faveur des incendies où il a déjà contribué au remplacement d’espèces indigènes
Un bilan de leur utilisation est prévu et permettra de poursuivre l’amélioration des connaissances quant au transport de propagules par les usagers et d’évaluer l’effet bénéfique de l’utilisation de ces stations sur les milieux naturels.
Un premier bilan global
Bien que ces résultats ne reflètent sans doute que très partiellement l’efficacité de ces stations de biosécurité, il est désormais avéré qu’elles peuvent contribuer à freiner la propagation des PEE le long des sentiers de randonnée. Par leur présence sur les sentiers et leurs informations accessibles, ces stations sont des outils indéniables de sensibilisation permettant une mobilisation directe des usagers qui se retrouvent alors acteurs majeurs de la biosécurité par l’application de bonnes pratiques. Cette mobilisation pourrait d’ailleurs faciliter dans ces sites la réduction de l’implication permanente des gestionnaires déjà très engagés sur des chantiers de régulation de PEE comme par exemple sur le réseau des aires de contrôle intensif (ACI). Enfin, tout comme ce réseau, ces stations de biosécurité s’appuient sur le travail collégial de spatialisation des secteurs prioritaires pour la gestion des PEE à La Réunion et font donc partie intégrante de la démarche stratégique en cours à l’échelle de l’île.
Vers une utilisation de ces stations sur d’autres îles : installations en cours en Martinique
Face aux enjeux que représentent également les PEE sur cette île, l’ONF Martinique a bénéficié de l’appui de ses collègues réunionnais pour la conception de deux stations de biosécurité installées en octobre 2024 à l’entrée de la Réserve biologique intégrale (RBI) de la Montagne pelée au départ du sentier de l’Aileron (Fig 10) et dans la RBI des Pitons du Carbet à l’entrée de la trace des Jésuites (Fig 11). Comme celles mises en place à La Réunion, ces stations sont équipées d’un mode d’emploi adressé aux randonneurs et les sites ont été choisis pour leur niveau de fréquentation élevé, leur risque d’exposition aux PEE et leurs milieux naturels emblématiques à protéger.
 10- Station de biosécurité installée à l’entrée du sentier de l’Aileron et de la RBI de la Montagne Pelée (c) ONF Martinique |
 11 – Station de biosécurité installée à l’entrée de l’entrée du sentier de la trace des Jésuites dans la RBI des Pitons du Carbet (ONF Martinique) |
Il est à souhaiter que l’installation de ces deux stations ne soient que la première étape d’une démarche plus globale de prévention d’introduction et de dispersion des plantes exotiques au sein du réseau des sentiers en Martinique. D’autres pourront éventuellement être installées en 2025 sur d’autres sites.
En savoir plus
- PNRun (2023). Déploiement de 3 nouvelles stations de biosécurité – Les randonneurs acteurs de la lutte contre les plantes invasives. Communiqué de presse – 05 juin 2023 (lien)
- PNRun (2023). Expérimentation d’un dispositif de biosécurité sur des sentier en coeur de parc national : Les randonneurs acteurs de la lutte contre les plantes invasives. Dossier de presse – 4 mai 2023 (lien)
- PNRun (2020). Mise en oeuvre de mesures de biosécurité dans le cadre des missions de terrain effectuées par les agents du Parc national de La Réunion. 16 p. (lien)
- Roussel S.,Rochier T. & Lavergne C. (2022). Suivi des germinations issues du dispositif de biosécurité installé sur le sentier de Grand Coude – Morne Langevin (Saint-Joseph). Rapport technique non publié, CBN-CPIE Mascarin, Saint-Leu, 21 p. + annexes. (lien)
- Rochier T. (2019) – Suivi de germination des semences collectées sous les semelles des participants à la course passant par le sentier 3 sources (Saint-Joseph) en 2018. Rapport technique non publié, Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Mascarin, Saint-Leu, 16 p. + annexes. (lien)
Rédaction : Clara Singh (Comité français de l’UICN)
Relectures et contributions : Alain Dutatre (Expert indépendant), Marine Dijoux et Marc Salamolard (PNRun) et Iris Abu Baker (ONF Martinique)